dossier Deliveroo
Consommer les travailleurs
Martin Willems est permanent au sein de la centrale des syndicats chrétiens (CSC). Depuis 2017, il lutte inlassablement aux côtés des livreurs, de Deliveroo comme d’autres entreprises, pour tenter d’arracher le statut de salarié auquel ils ont droit. Rencontre.

Les techniques managériales des entreprises dites de plateformes, et leur façon de s’imposer tout en contournant la plupart des droits sociaux des travailleurs, sont progressivement apparues pour ce qu’elles sont : une menace pesant sur la totalité du monde du travail. Après une période de « flottement » au début de leur apparition, les pratiques de ces entreprises sont progressivement devenues sources de préoccupations pour les organisations syndicales.
S’il y en a bien un qui incarne la prise en considération de ce danger par le syndicalisme traditionnel en Belgique, c’est notre interlocuteur : Martin Willems est actif au sein de United Freelancers, un groupe émanant de la Confédération des syndicats chrétiens (CSC), qui intègre dans ses combats les défis et enjeux liés aux livreurs de plats cuisinés, et le no man’s land juridique actuel dans lequel ils évoluent. Même s’il qualifie lui-même sa place au sein de la CSC comme quelque peu « atypique », depuis des années il accompagne les livreurs dans leurs luttes pour faire reconnaître leur statut de salarié. Il est l’auteur d’un livre dont le sous-titre trône au-dessus de cette page : « Le piège Deliveroo. Consommer les travailleurs ». Cet ouvrage propose un tour complet des questions sociales posées par l’entreprise pour laquelle a presté notre témoin livreur sans-papiers (lire ici).
En ce jour froid et gris nous faisons face à un homme déterminé, et surtout scandalisé par l’inaction complice des pouvoirs publics suite à une décision de justice majeure, non suivie d’effet un an plus tard. Il commente avec nous l’actualité chaude des livreurs cyclistes de plats cuisinés.
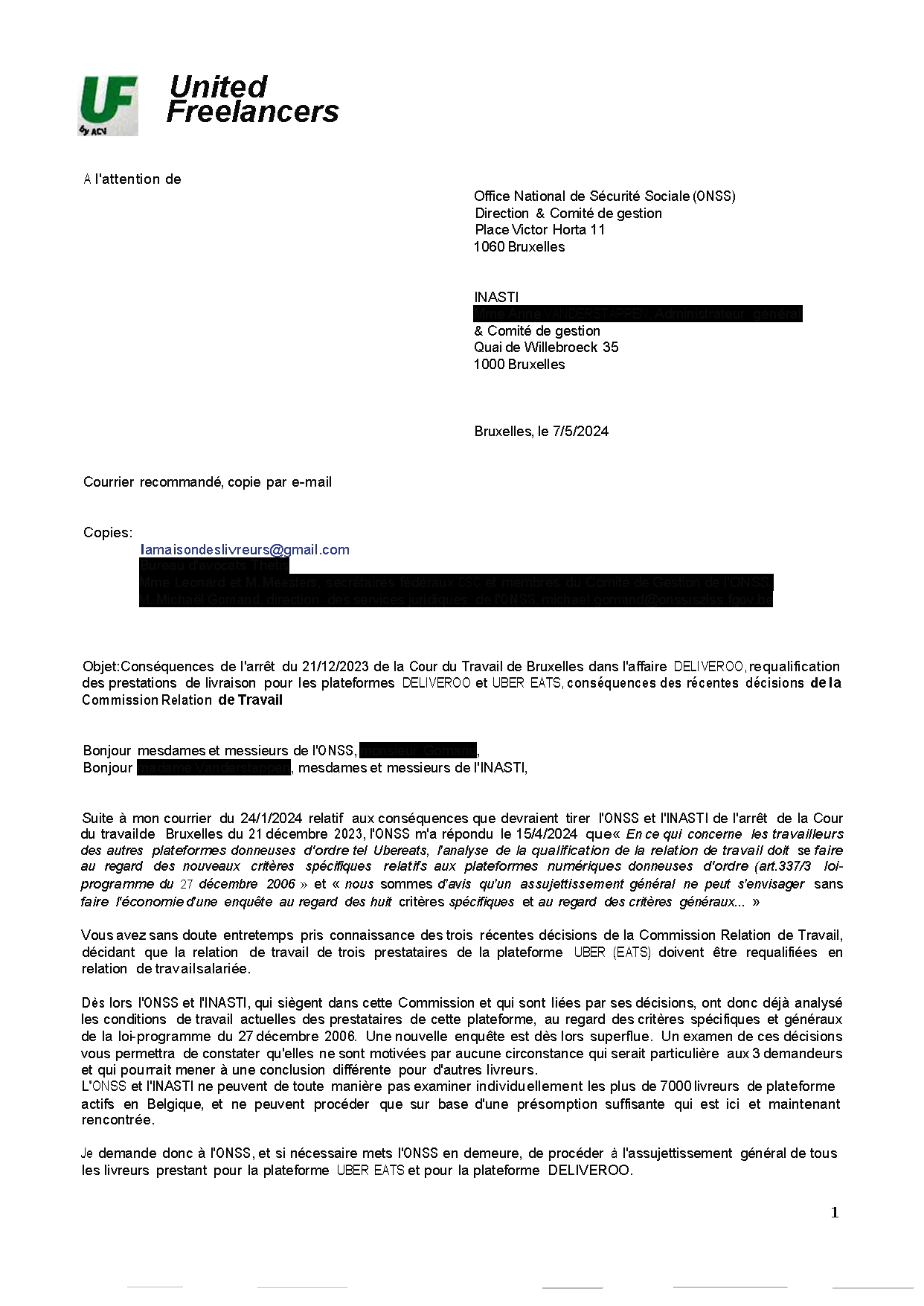
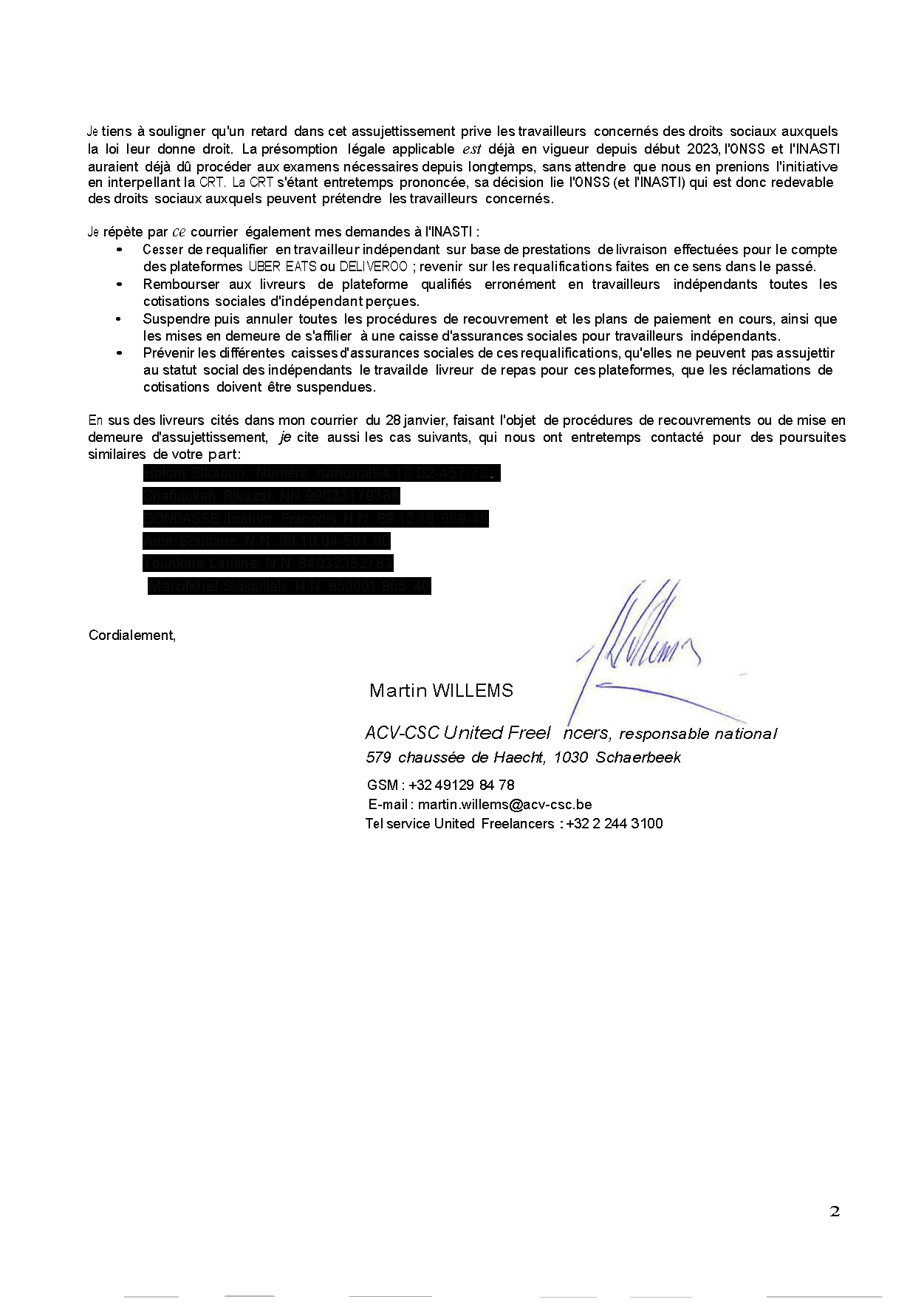
Le piège Deliveroo
« Leur marketing est séducteur. Racoleur même, pour les candidats-coursiers. Selon Deliveroo, travailler serait un jeu : ‘‘Ouvrez l’appli, et commencez à gagner de l’argent !’’ »
Sous prétexte d’innovation, un nouveau patronat prend tous les avantages et ne se reconnaît aucune obligation. Si, dans le monde 2.0, le droit du travail et la Sécurité sociale n’existent plus, les autres entreprises s’engouffreront dans la brèche.
Syndicaliste, Martin Willems a accompagné les premiers coursiers qui ont résisté en Belgique. Son enquête dévoile la réalité quotidienne de ces travailleurs précaires. En niant ses responsabilités de patron, en se dissimulant derrière le Web et ses algorithmes, Deliveroo exploite ses livreurs. Toujours plus mal rémunérés, guère assurés malgré les risques élevés d’accident, empêtrés dans les problèmes fiscaux, ils sont consommés en quelques mois par le bulldozer digital.
Partis politiques, syndicats, Union européenne et tribunaux laisseront-ils la régression sociale, sous ses nouveaux habits, détruire le droit du travail ? »
Voilà comment l’éditeur nous présente, en quatrième de couverture, l’ouvrage de Martin Willems, très justement sous-titré « Consommer les travailleurs ». L’auteur nous propose une présentation exhaustive des enjeux de société liés au développement des entreprises officiant dans l’économie dite « de plateforme », en se focalisant sur une entreprise emblématique de ce secteur : Deliveroo.
Afin de faire écho à la rencontre avec notre témoin, livreur sans-papier pour Deliveroo (lire ici), nous avons développé avec Martin Willems les caractéristiques et enjeux plus globaux de cette activité, sans toutefois prétendre à l’exhaustivité. Nous invitons les lectrices et lecteurs intéressés à se plonger dans cet ouvrage très complet : il aborde le mode de vie des livreurs, leurs (non-)statuts, etc, mais nous présente également Deliveroo en détail, cette entreprise de sape des droits sociaux créée en Grande-Bretagne en 2013, active depuis lors dans de nombreux pays du monde, ainsi qu’en Belgique depuis 2015.
L’ouvrage se termine par une postface, « Récit d’une lutte hors-piste », rédigée par Douglas Sepulchre, un coursier actif dès les débuts de la livraison à vélo à Bruxelles, au sein de l’entreprise pionnière en Belgique, Take Eat Easy. Il a été l’un des fondateurs du tout premier Collectif des livreurs et, à ce titre, a initié la lutte pour de meilleures conditions de travail dans ce secteur naissant. Dès le début, ce collectif va se confronter aux patrons de ces entreprises de plateformes profitant des possibilités du numérique, et à leur cynisme radical. Il raconte très justement la naïveté des débuts, devant un discours en apparence cool des responsables de l’entreprise. « Les patrons et managers de Take Eat Easy étaient tous des petit bourgeois d’environ 25 ans qui sortaient tout juste d’écoles de commerce. Dans ces grandes écoles, ils n’avaient rien appris sur le monde du travail et ses conflits. » Eux qui agissaient jusque-là en toute impunité se sont donc retrouvés bouche bée devant le premier acte de révolte d’un travailleur ! Ce récit, plutôt jubilatoire, raconte la pose des bases du syndicalisme dans un nouveau secteur économique marqué par une exploitation extrême de la force de travail.
Ensemble ! Avant de rentrer dans le vif du sujet, pourriez-vous présenter United Freelancers, une émanation de la confédération des syndicats chrétiens (CSC), qui intègre dans ses préoccupations les travailleurs de l’économie dite de plateforme ?
Martin Willems : Officiellement, United Freelancers est né en 2020, mais après une longue réflexion et une maturation commencée en 2014…. Ce groupe n’est pas centré sur le travail de plateforme, il s’agit plutôt d’une évolution parallèle. En 2014, je suis un permanent syndical, disons « classique », et nous posons avec différents collègues ce constat : dans beaucoup de lieux se développe une nouvelle forme de travail, le travail freelance. Aujourd’hui, dix ans plus tard, cette tendance s’est hélas largement étendue, pour confirmer nos craintes et révéler une réalité présente dans tous les secteurs, de la construction aux soins de santé, en passant par le journalisme. Dans ce dernier secteur par exemple, cela devient carrément la norme, lorsqu’on « commence » comme journaliste – avec des guillemets car ça peut durer dix ou quinze ans -, on est la plupart du temps pigiste, journaliste freelance.
Cette généralisation du freelance contourne complètement le droit du travail : nous avons alors un travailleur, sur un lieu de travail où évoluent également des salariés, pour lequel ne s’applique aucune des règles fondamentales de ce droit du travail. Car pour les freelances, il n’existe même plus un salaire minimum, certains sont régulièrement payés en dessous de celui-ci, et nous constatons en outre la disparition de tout concept de durée du travail. Ils peuvent prester énormément d’heures à certains moments, et à d’autres se trouver dans une forme de « contrat zéro heure », travaillant « à l’appel », quand on leur propose une « mission ». Ils ne sont jamais assurés de rien, ni de travail ni de salaire, et cette réalité s’étend, nous l’observons tous les jours, dans des tas de secteurs. Des pensionnés travaillent également en freelance par exemple, et aujourd’hui des offres d’emploi paraissent, demandant ouvertement des freelances.
Devant ces constats, nous avons décidé de ne pas aborder ces réalités et ces travailleurs avec une « vision classique », en les considérant comme « des aberrations du système », et point à la ligne… Le trait principal est qu’ils sont traités comme des indépendants – nous rejoignons ici un trait des travailleurs de plateformes -, ce qu’ils ne sont en réalité pas car ils ne décident nullement de leur travail, de ses conditions, etc. Nous les abordons dès lors en les invitant à défendre leurs conditions de travail, tout simplement, ce avec quoi tous les publics de freelance rencontrés sont d’accord.
Le syndicalisme est en réalité encore plus pertinent pour eux que pour les salariés, car ils font face à une partie qui fait semblant de négocier – parfois ! – puis impose les conditions de travail. Pour ces travailleurs, comme pour tous, l’action collective est la plus pertinente pour défendre les conditions de travail, nous ne sommes jamais plus forts qu’ensemble. Avec ces travailleurs, nous ne partons pas d’une vision théorique, mais vraiment d’une vision concrète, observée sur le terrain du monde du travail. Voilà comment est né United Freelancers.
Comment, dans ce processus, sont arrivés les livreurs à vélo prestant pour des plateformes ?
En parallèle au développement de United freelancers, nous avons été contactés par ces travailleurs, plus précisément par des livreurs de Deliveroo qui avaient lancé un « Collectif des coursiers ». Ils sollicitaient le syndicat pour les épauler dans leurs combats, et il se fait qu’en interne cette demande est arrivée vers moi, sans doute en raison du fait que je m’occupais de Deliveroo en tant qu’entreprise – une trentaine de salariés à l’époque -, et j’ai de suite abondé dans le sens d’un soutien à leur lutte. United Freelancers, dont la vocation était de s’occuper des travailleurs évoluant sans les liens réels d’un contrat de travail, mais sur des lieux plus classiques, ont assez naturellement intégré dans leur lutte ces travailleurs, placés directement dans cette situation.
Concernant les salariés de Deliveroo – les administratifs dans les bureaux -, ils sont aujourd’hui moins nombreux car les travailleurs de leur call center ont par exemple été licenciés, en juillet 2017. Deliveroo a trouvé plus « pratique » – c’est à dire moins cher – de sous-traiter le call center à Madagascar. Ce licenciement a d’ailleurs déclenché l’une des mobilisations des livreurs – ce call center étant leur seul contact avec l’entreprise, qu’ils appelaient en cas de problème lors de leurs prestations. D’un coup, il n’y avait plus personne, sauf très loin d’ici… Si on veut ironiser, il faut visualiser la scène, le livreur appelle en signalant par exemple des problèmes de verglas : « Je me suis cassé la jambe, je fais quoi ? », et le travailleur au bout du fil, lui, s’il regarde par la fenêtre, voit au même moment un soleil rayonnant !
Cela dit, c’est important de le signaler, certains travailleurs de plateforme, dans la livraison également, sont aujourd’hui salariés : l’exemple-type est pour nous Take Away, concurrent direct de Deliveroo. S’ils sont dès lors intégrés plus naturellement au syndicalisme traditionnel, United Freelancers travaille également avec eux, avec ses visions et expériences du secteur.
Des enjeux pour l’ensemble du monde du travail
Les pratiques des entreprises de plateforme risquent de faire tache d’huile dans tous les secteurs d’activités : c’est là sans doute que réside l’un de leurs plus grands dangers.
Martin Willems : « Il faut absolument insister sur un élément : les questions posées par ces plateformes et le travail des livreurs dépassent largement leur cas précis. Les pratiques de ces entreprises sont en réalité emblématiques d’une évolution. Dans l’immédiat, il est absolument nécessaire de trouver une solution pour ces travailleurs-là : il est totalement inacceptable et anormal de travailler dans ces conditions-là. Mais ce qui est en jeu est bien plus large. Ces entreprise agissent tel un « Cheval de Troie » de la dérégulation du travail. Nous assistons à un test grandeur nature d’une activité économique, impliquant de nombreux travailleurs, dont l’organisation échappe au Droit du travail. Si on tolère ces contournements – ce que semblent faire les autorités actuellement -, ça va de facto se répandre dans tous les domaines d’activité.
Déjà aujourd’hui, des entreprises traditionnelles se « plateformisent ». Prenons l’exemple des taxis à Bruxelles. Nous avions des entreprises classiques de taxis, puis est arrivé Uber. Dans un premier temps, tout le secteur des taxis s’est opposé à Uber, mais aujourd’hui qu’ils ne peuvent plus s’y opposer. Que font dès lors les entreprises classiques de taxi ? Elles fonctionnent exactement comme Uber, et même à certains points de vue, leurs pratiques sont parfois encore pires. Cette forme de travail dérégulé a contaminé tout un secteur. Prenons un autre exemple, avec une entreprise de livraisons active en région liégeoise, KM Group. L’été dernier, cette entreprise a licencié tous ses travailleurs par Whatsapp. Tout le monde s’est focalisé sur cet élément : peut-on licencier par cette voie ? En creusant l’affaire, on a découvert que cette entreprise était en fait un sous-traitant d’Amazon. Les travailleurs avaient en quelque sorte un double patron, un patron à deux têtes. Formellement, ils étaient salariés de KM Group, avec des contrats à durée déterminée (CDD) d’un mois, une forme de travail précaire, mais ils avaient aussi un compte sur Amazon Flex, la plateforme d’Amazon qui gère le système de livraison de colis. Tous les colis sont suivis sur Amazon Flex, et tous les livreurs y ont un compte, exactement comme les livreurs de Deliveroo qui se connectent sur le site de leur entreprise. Que s’est-il passé en réalité ? Les travailleurs ont constaté être désactivés de la plateforme, ils ont pris contact avec KM Group qui a répondu « Vous êtes licenciés ». Qui était le vrai patron ? De l’extérieur, l’entreprise avait l’air, disons, traditionnelle, mais dans les faits il s’agissait d’une entreprise de plateforme, sous-traitante d’Amazon. Comme pour Deliveroo qui déconnecte ses travailleurs, ils ont licencié des travailleurs sans leur dire pourquoi, ce qui normalement n’est pas permis en droit belge. Car KM Group licencie, simplement, en signalant au travailleur : « Vous n’avez plus de compte chez Amazon, donc vous ne pouvez plus travailler avec nous ».
Dans une des notes de Bart De Wever (NV-A), durant son travail de formateur pour créer un gouvernement fédéral dès juin 2024, des éléments allaient dans le sens d’une ubérisation générale du monde du travail. Il prévoyait par exemple de supprimer la durée du travail, ce qui peut sembler abscons pour un observateur extérieur, mais supprimer la durée du travail, ça signifie dans les faits créer des « contrats zéro heure » : des contrats de travail dans lesquels on ne garantit plus aucun volume de travail. Le travailleur a un contrat, sans savoir s’il travaillera beaucoup, un peu ou pas du tout. Le travailleur l’apprendra de semaine en semaine ou, pourquoi pas, au jour le jour… « S’il y a du travail, on vous appelle, s’il n’y en a pas, on ne vous appelle pas. » Vous êtes lié à un patron, mais vous ne savez pas combien vous allez gagner. C’était dans la note De Wever, et c’est typique de l’ubérisation, avec également des éléments de paiements à la tâche. On ne sait jamais, quand on commence, combien on va gagner, ça dépend du nombre de commandes. La crainte est immense que l’ubérisation se répande comme une tache d’huile sur l’ensemble du monde du travail, ou du moins sur des pans entiers, car la contamination est réelle.
Je vais peut-être sembler être un oiseau de mauvais augure, mais si on n’arrête pas ça, dans cinq ans, dix ou vingt ans, si on n’agit pas fermement, toute l’économie sera ‘‘ubérisée’’. Nous sentons une volonté de passer largement à des conditions de travail où la personne est en réalité payée à la pièce, et où il n’y a plus d’application du droit du travail : nous l’observons dans d’autres secteurs, tout à fait traditionnels. »
En 2015, les premiers livreurs sont tous indépendants. Ensuite, un partenariat est mis en place avec la Smart, pour créer un salariat en « triangulation » (lire ici). La convention avec la Smart est rompue en 2018, un moment-clef pour le secteur.
Au tout début de cette activité de livraison, avec la première entreprise Take Eat Easy,lorsque les travailleurs sont indépendants, c’est finalement resté assez confidentiel, ça n’a pas concerné beaucoup de monde et n’a pas duré très longtemps. Ensuite, en 2016, cette entreprise a fait faillite et Deliveroo a repris les livreurs désireux de continuer. Assez vite, Deliveroo a en effet réalisé un accord avec la Smart : les livreurs passaient par la coopérative, qui refacturait ensuite leurs prestations à Deliveroo. Formellement, ces travailleurs étaient salariés de Smart, avec l’avantage pour Deliveroo de ne pas être directement l’employeur mais, à la différence – majeure – de la situation actuelle, ils étaient payés à l’heure. C’est lorsque la convention avec la Smart a été rompue par Deliveroo que nous avons compris leur volonté principale : passer au paiement à la livraison, pour éviter un salaire horaire.
C’est fondamental, car alors tout le risque économique repose sur les épaules du livreur. Les plateformes peuvent mobiliser de nombreux livreurs – beaucoup – et ne les payer que s’il y a des courses à réaliser. Les incertitudes quant au nombre des commandes ne représente même plus un risque pour l’entreprise : s’il n’y a pas de courses, les livreurs restent à quai, ils ne sont pas payés, et voilà tout. Ce changement fondamental a provoqué un mouvement social chez les livreurs : à défaut d’être rémunérés à l’heure par l’intermédiaire de la Smart, ils revendiquaient le fait de devenir pleinement salariés de leur entreprise.
Quels sont les liens entre la rupture de cette convention avec la Smart et l’arrivée de la loi De Croo sur l’économie collaborative ?
La loi De Croo date du premier juillet 2016, elle introduit un système dit « peer to peer » (P2P), prévu en réalité pour des petites prestations entre particuliers. Au départ, ça reste confidentiel mais, dès le début de l’année 2018, au moment de la rupture de la convention Smart, ce régime P2P a été utilisé par Deliveroo et Uber Eats à très large échelle. Avec ce régime, on peut gagner jusqu’à 7.460 euros bruts (6.650 euros nets) – un plafond pas très élevé donc. Sur cette somme est appliqué, non pas un précompte, mais un impôt forfaitaire libératoire de 10,7 %. Un prélèvement qui est loin d’être insignifiant lorsqu’on sait qu’en Belgique, normalement, lorsqu’on gagne moins de 10.000 euros par an, on paie 0 % d’impôts. En réalité, ces travailleurs sont soumis à un impôt relativement important, alors que s’ils étaient salariés, avec une telle rémunération, ils n’en paieraient pas.
La grande caractéristique de ce régime, nous utilisons ce terme sciemment car il ne s’agit pas d’un statut, est qu’il n’y a pas de cotisation sociale à payer, il contourne le droit social et ne procure aucun statut social à ceux qui le subissent. Lorsqu’un travailleur preste uniquement pour les plateformes, dans le régime P2P, il n’est ni salarié, ni indépendant, dès lors il ne rejoint aucun des systèmes de la Sécurité sociale. C’est fondamental, ces livreurs se trouvent en dehors des radars sociaux.
Cette loi est une aubaine pour les entreprises comme Deliveroo qui en sont les principaux utilisateurs : on pourrait la croire élaborée spécialement pour eux.
Au Parlement, les débats décrivent une loi prévue pour encadrer les petits services entre voisins : si par exemple vous préparez plus de repas et en vendez des parts à vos voisins, ce genre de choses… Officiellement, l’idée est en quelque sorte de légaliser des petites activités menées « au noir », lorsqu’il y a un échange de compétences ou de matériel à un niveau local. Les termes « économie collaborative » font référence à une économie de ce type, et des plateformes de « partage » existent bel et bien, mais c’est très marginal… Surtout : il est certain que les plateformes dont nous parlons, Deliveroo et Uber Eats, n’évoluent clairement pas dans une « économie de partage ». C’est simplement une évidence mais surtout, dans la loi, les services de livraisons de plats sont explicitement exclus de son champ d’application ! Or aujourd’hui, bizarrement, ces systèmes de livraison sont les principaux utilisateurs du système d’économie collaborative.
Politiquement, cette loi a été initiée par les libéraux, flamands et francophones. Qu’avaient-ils en tête ? Imaginaient-ils par ce système, dès son élaboration, créer un « Cheval de Troie » de l’évitement légalisé des réglementations sociales, comme c’est le cas actuellement dans les faits ?
Dès 2018, les plateformes ont commencé à utiliser ce régime de manière industrielle. Elles ont très vite été rattrapées par l’administration fiscale. Dès juin 2018, elle leur a signifié très clairement : « Attention, vous ne pouvez pas utiliser le régime de l’économie collaborative ». Suite à cet avertissement, Deliveroo a envoyé des avocats discuter avec le ministère des Finances qui a, tenez-vous bien, confirmé fin 2018 – début 2019, qu’en effet le régime de l’économie collaborative n’était pas prévu pour ces plateformes. J’ai à ce moment-là interrogé l’entreprise, en ces termes : « Énormément de personnes travaillent pour Deliveroo dans le cadre de l’économie collaborative, or vous ne pouvez pas. Que se passe-t-il ? » Le patron nous a répondu, le plus simplement du monde : « Oui, nous envisageons en effet la poursuite du P2P, nos avocats nous ont prévenu que théoriquement nous ne pouvions pas, mais nous allons négocier avec l’administration fiscale… » Mais qui sont-ils pour discuter avec l’administration fiscale de notre État, lorsqu’une autorité politique leur signifie, explicitement, qu’une loi ne s’applique pas à leurs activités ? Pour qui se prennent-ils ?
Et pourtant… Fin 2019, Alexander de Croo est nommé au ministère des Finances et, étonnamment, à partir de 2020, Deliveroo et Uber Eats ont bénéficié d’un ruling (1), une sorte de régularisation, d’autorisation spéciale, leur permettant d’utiliser le régime. Nous en sommes encore là aujourd’hui, malgré de nombreuses procédures et procès, tous gagnés par les entreprises de plateformes. L’impunité est totale.
D’où viennent les fonds de départ de ces entreprises ?
Nous lisons régulièrement que ces entreprises de plateformes ne sont pas rentables. Pourtant elles entrent en bourse, exploitent radicalement les travailleurs… Quels sont les sentiments du syndicat à ce sujet ?
Martin Willems. Il est difficile de se faire une idée claire, car le fonctionnement de ces entreprises est très opaque. Si l’on se penche par exemple sur les comptes de Uber Eats, déposés à la Banque nationale en 2022, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 43 millions, pour un bénéfice net de 653.000 euros. Est-ce seulement lié à la livraison, à d’autres activités ? Ont-ils payé des impôts sur ce bénéfice ? Ils ne créent déjà pas d’emploi, mais paient-ils des impôts sur leurs bénéfices ?
J’ai longtemps pensé, au début du phénomène, que les investisseurs attendaient de voir comment ça allait se développer, pour ensuite peut-être se retirer… Sans doute que certains se sont retirés, mais il ne semble en tout cas pas, pour Deliveroo, que des investisseurs se soient dit : « J’investis aujourd’hui, mais je dois récupérer mes billes, avec une grosse plus-value, dans dix ans ». Non, ceux qui investissent dans Deliveroo le font pour des raisons idéologiques : promouvoir le développement d’un autre modèle. Avant l’entrée en Bourse – et c’est toujours le cas aujourd’hui -, le plus gros actionnaire de Deliveroo était la multinationale Amazon. Amazon voit arriver et s’imposer d’autres Chevaux de Troie d’un modèle d’entreprises destructrices du système social – ce qu’elle est elle-même -, qui trouvent des clients et des travailleurs précaires. Elle se dit simplement « C’est notre combat également, finançons-les ! »
Leur vision idéologique et leurs actes affirment une volonté de faire éclater le système social. Point. Ils ne sont pas seuls : pourquoi des milliardaires achètent-ils des journaux, par exemple ? Pas pour gagner de l’argent, et certainement pas pour sauver la presse, non : c’est pour faire passer un point de vue, imposer une idéologie. Voilà à quoi nous devons faire face : une offensive majeure dont le but est de remettre en question notre modèle social. Et, au passage, la démocratie.
Le caractère principal du P2P, la possibilité du paiement à la course sans aucune certitude pour un travailleur de bénéficier de revenus, nous ramène à des scènes du passé vues par exemple dans le film Sur les quais d’Elia Kazan, avec Marlon Brando : les employeurs viennent au port et y choisissent leurs travailleurs au jour le jour. Avec Deliveroo, nous revenons à ce genre de situation, dans laquelle le choix du travailleur est, de surcroît, délégué à une machine et un algorithme.
L’analogie est hélas pertinente, mais c’est pire encore car, pour ces dockers, le choix se faisait pour la journée, ici le livreur est choisi pour vingt minutes, à la suite desquelles il est à nouveau dans l’attente. Parfois les courses se succèdent, mais c’est loin d’être garanti, et régulièrement des livreurs témoignent en ce sens : « J’ai eu trois courses en trois heures, pour le reste j’étais en attente ». Des courses à cinq euros. Le temps d’attente entre deux courses est gagné par Deliveroo, de même pour le temps d’attente au restaurant, lorsque le livreur arrive et que la commande n’est pas prête. Ça arrive régulièrement, et il peut parfois attendre une demi-heure. En prenant une course, impossible de prévoir le temps que durera le travail, certains abandonnent des courses pour cette raison mais ils ont alors perdu trois quarts d’heure, personne ne va la leur payer, et ils risquent d’être « sanctionnés » par l’algorithme, programmé pour ensuite envoyer moins de commandes à ces livreurs-là.
Le paiement à la course est également de rigueur pour les indépendants, mais le problème principal avec le P2P est qu’on ne crée aucun cadre social, aucun statut. En tant qu’indépendant, la situation est un peu meilleure puisqu’elle correspond à un statut social. Mais il est impossible d’être indépendant de manière viable en n’effectuant que ces livraisons. Plusieurs ont essayé, ils ont dû prester soixante heures par semaine. Dans les faits, ce paiement à la course est aujourd’hui l’élément à la base du système d’exploitation de la force de travail.
Si après un jugement défavorable, Deliveroo et Uber Eats veulent quitter le pays, ce qu’ils menacent parfois de faire, c’est leur choix, grand bien leur fasse… Mais le service va rester, que les plateformes soient Deliveroo ou autre chose, peu importe, s’ils partent ils seront très vite remplacés. Take Away, qui fonctionne déjà avec du salariat, peut reprendre l’ensemble du marché, par exemple. Il nous faut constater l’existence de clients pour utiliser ces services de livraison, et de travailleurs prêts à réaliser le travail, très nombreux, mais des personnes très précaires en besoin extrême de revenus, même s’ils sont dérisoires… Nous avons pensé un moment que le nombre de candidats livreurs se tasserait, créant alors un rapport de forces plus favorable, mais le renouvellement est permanent. Nous n’avons rien a priori contre les plateformes en soi, nous voulons juste que leurs travailleurs soient traités correctement, soient bien rémunérés par les plateformes, et qu’ils puissent faire leur boulot dans de bonnes conditions de travail. Aujourd’hui, Deliveroo et Uber Eats prennent les travailleurs, se servent, puis les jettent comme des kleenex. Aucune discussion n’est possible, et les autorités laissent faire.
Vous évoquez Take Away : comment se fait-il que les responsables de cette entreprise n’interviennent pas davantage dans les débats, pour mettre en avant leurs agissements « vertueux », c’est-à-dire le fait qu’ils salarisent leurs travailleurs et les paient à l’heure, pour exactement le même travail ?
Avec eux, nous commençons à réaliser un travail syndical classique, ils ont par exemple organisé des élections sociales et ont élu des représentants du personnel : tout n’est pas rose mais tout se discute… Nous avons tenté de les encourager à participer à un processus de lobbying politique, par exemple en allant rencontrer le ministre du Travail socialiste de la dernière législature, à savoir Pierre-Yves Dermagne. Nous avons bien insisté sur les conséquences de la situation actuelle en termes de conditions de travail, posées par les actes de Deliveroo et Uber Eats et plaçant Take Away, de fait, dans une situation d’intense concurrence déloyale.
Take Away a très clairement demandé au ministre de leur indiquer le statut à utiliser, en ces termes : « Nous pensions que le statut de salarié devait s’appliquer, mais nous ne cessons de constater la possibilité de faire travailler les livreurs en indépendant ou en P2P. S’il en est comme ça en Belgique, nous devrons passer à ce régime également. » Nous avons alors alerté le ministre : le mauvais emploi chasse le bon. La situation actuelle tire tout vers le bas, et Take Away n’est pas une petite entreprise belge, il s’agit également d’un groupe international. En France, ils ont licencié tous les salariés pour les faire passer sous statut d’auto-entrepreneur. Forcément : ils ne vont pas indéfiniment accepter cette situation de concurrence déloyale que l’on doit à la complicité des autorités.
Parmi le grand nombre de livreurs, on trouve une proportion non négligeable de travailleurs sans-papiers, ultra-précaires et forcément peu exigeants sur les conditions salariales. Notre discussion est destinée à accompagner le « récit de vie » de l’un de ces travailleurs (lire ici). Le jeune homme a dû payer 700 euros à un étudiant de l’Université libre de Bruxelles (ULB) pour pouvoir utiliser son compte, ce qui prouve l’existence d’un système relativement bien organisé de trafic de faux comptes… Selon vous, cette pratique est répandue, marginale ?
Sans aucun doute, les prestations sous de faux comptes sont très répandues. C’est une estimation bien sûr, mais au moins un livreur sur deux travaille sur le compte et sous le nom de quelqu’un d’autre. Cela dit, ces travailleurs ne sont pas tous sans-papiers : différentes situations peuvent pousser à ça. La première tient au plafond annuel à ne pas dépasser, ces fameux 6.650 euros nets. Sans autre travail, ce n’est évidemment pas suffisant pour vivre. Un livreur peut prester sous son nom, puis reprendre un compte sous un autre nom une fois le plafond atteint. Sur une année civile, plusieurs prestations en P2P sont dès lors le fait d’un seul et unique travailleur. Une deuxième raison peut être que, si le livreur n’est pas majeur – or il faut l’être pour pouvoir ouvrir un compte chez Deliveroo et Uber Eats -, il se « cache » derrière un titulaire plus âgé. Sur le terrain, nous rencontrons des livreurs de 14, 15 ou 16 ans. Dans ce cas, les faux comptes se mettent souvent en place au sein du cercle familial.
Une autre raison encore apparaît lorsque le livreur perçoit des allocations de chômage ou du Centre Public d’Action Sociale (CPAS), et qu’il cherche à travailler dans les livraisons en complément. Avec le chômage, la combinaison est possible, mais si on preste dans l’économie collaborative, il faut alors noircir la case sur la carte de chômage, et renoncer aux allocations du jour. Dans ce cas, avant même de pédaler, le travailleur a déjà perdu des revenus. Au CPAS, c’est également possible, mais les sommes gagnées sont alors retirées des allocations – presque totalement si l’on n’est pas dans les conditions pour bénéficier de l’exonération socio-professionnelle -, on ne gagne rien en plus, donc on travaille pour rien. J’ai expliqué cela en détail, à plusieurs reprises, à des responsables politiques, qui me regardent alors avec des yeux de cabillauds : « Mais enfin, c’est bien que les gens travaillent ! ». Certes, mais ce serait surtout bien qu’ils travaillent pour gagner quelque chose !
Enfin, comme vous l’avez évoqué, une autre raison d’utiliser le compte d’un tiers est le fait d’être sans-papier. Quelle est la proportion de chaque situation ? C’est très difficile à dire, notamment car il y a de fortes chances qu’un sans-papier ne parle pas toujours de sa situation… Avec ma vision du terrain, j’estime que les sans-papiers doivent représenter, grosso modo, au moins 20 à 25 % des livreurs. Mais attention tous les livreurs, quasiment, sont d’origine étrangère, essentiellement de première génération, mais parfois aussi de deuxième ou troisième générations. Beaucoup ont des papiers, d’autres sont demandeurs d’asile, avec des papiers provisoires. Il peut y avoir une certaine concentration de faux comptes au sein d’un groupe communautaire précis : les compatriotes peuvent, par « solidarité », permettre ainsi au sans-papier d’accéder à une source de revenus. Mais la plupart du temps, l’utilisateur réel du faux compte ne peut utiliser ce compte que contre paiement à son titulaire.
Les plateformes prétendent lutter contre cette réalité, l’hypocrisie semble totale.
Oui, clairement les plateformes en profitent et, quelque part, en ont besoin. Nous sommes face à de l’hypocrisie mais celle-ci est également de rigueur dans d’autres secteurs qui reposent également grandement sur le travail des sans-papiers. Pour certaines tâches, tout le monde est bien content de l’existence de ce travail au noir, mais dans le cas de ces plateformes, elles en ont vraiment besoin dans leur modèle, pour ne devoir, à aucun moment, augmenter les prix pour les clients. Dans ce but, il faut un flux constant de livreurs, or ils sont nombreux à quitter la livraison… En moyenne, un livreur preste cinq mois de travail. Cela peut fluctuer, mais la moyenne est basse. Ça signifie que, chaque année, sur les 3.000 livreurs revendiqués par Deliveroo et Uber Eats, la moitié d’entre eux quittent ce travail. Ils doivent être remplacés, puisque c’est leur afflux constant qui garantit la mise à disposition d’une masse de travailleurs auxquels on peut imposer n’importe quelles conditions de travail.
Dans ce contexte, si les autorités demandent de lutter contre le travail des sans-papiers, ces plateformes vont déclarer qu’elles le font, mais en réalité elles ne peuvent réellement se le permettre. Prenons le système de reconnaissance faciale, en vertu duquel il faut envoyer une photo de soi tous les quinze jours, par exemple, pour que le compte reste actif : le travailleur effectif ira voir tous les quinze jours la personne officiellement titulaire du compte pour le prendre en photo, et voilà tout. Si l’entreprise voulait réellement combattre le travail au noir, elle pourrait exiger la photo tous les jours, et vérifier l’identité du prestataire avant chaque shift.
Au fond, pourquoi est-il possible de travailler sous un faux compte ? Avant tout parce que, pour la personne qui cède un compte à quelqu’un, contre rémunération ou non, les revenus du régime de l’économie collaborative ne s’additionnent pas à ses revenus personnels. Ils apparaîtront sur la fiche fiscale, mais ne s’additionneront pas dans le calcul d’impôts. S’il n’en allait pas ainsi, si ces revenus P2P entraînaient une hausse d’impôts, il est évident que l’étudiant de l’ULB que vous évoquez ne ferait jamais ça. Ce système est possible car les revenus sont seulement taxés à la source, à hauteur de 10,7 %. Ne pas globaliser tous les revenus du travail est une aberration. Qu’à côté vous ne gagniez rien, ou que vous gagniez 200.000 euros, vous payerez le même impôt : c’est absurde ! Et pour celui qui ne gagne rien à côté des revenus P2P, cet impôt de 10 ,7%, c’est élevé.
Si cette réalité des sans-papiers devient structurelle, avec un tel usage industriel, il semble possible d’évoquer de l’exploitation à grande échelle de main-d’œuvre étrangère.
La question se pose, en effet (lire également l’encadré) Cependant, la situation est très complexe : certains de ces travailleurs n’ont aucun autre revenu, ont besoin de conserver ce qu’ils gagnent par le biais des plateformes, et ne désirent pas qu’on dénonce leur situation. Des sans-papiers nous ont déjà dit qu’ils n’entendaient pas se battre pour acquérir le statut de salariés car, « alors, ce boulot ne sera plus pour nous. » Certes, mais nous ne pouvons répondre qu’une chose, la réalité : ce n’est même pas nous qui, à la base, affirmons la nécessité du statut salarié, c’est la loi ! Elle affirme qu’en cas de lien de subordination, il y a salariat. Si nous comprenons bien leur situation, nous revendiquons simplement l’application du droit du travail et n’allons pas cesser le combat pour des conditions de travail décentes en raison de la présence de sans-papiers dans le secteur. Ils sont présents également ailleurs, dans la construction par exemple : devrait-on donc raboter les droits partout ? Nous n’allons bien entendu pas participer à la course vers le bas, et accepter des salaires de misère…
Par contre, en parallèle, nous essayons de travailler à un combat en faveur de la régularisation des sans-papiers : nous ne pouvons accepter qu’une personne ait par exemple travaillé trois ans pour une plateforme, et que ce boulot ne lui procure aucun droit. La régularisation est en général basée sur le travail, nous bâtissons donc des dossiers avec les personnes concernées, mais il faut admettre qu’en Belgique, à ce jour, il n’y a pas de système de régularisation automatique. Il faudra aller l’arracher, et avec les rapports de force politiques actuels, ça risque de ne pas être simple.
Une autre question, non-évoquée encore pour ce statut P2P, est que les problèmes sont accentués par le manque de transparence et d’information livrée par l’entreprise aux travailleurs, car il arrive régulièrement des catastrophes en cas de dépassement du plafond de revenus annuels autorisés. Quand les livreurs sont automatiquement requalifiés comme indépendants depuis le début de l’année calendrier, certains doivent payer d’un coup 5.000, voire 15.000 euros de cotisations sociales à l’ONSS , et c’est catastrophique. Ça l’est aussi si le livreur perçoit des allocations de chômage et doit subitement tout rembourser à l’ONEm. Dernièrement, un livreur a dû rembourser 38.000 euros : une dette qui risque de le poursuivre toute sa vie.
Pour introduire la discussion sur le procès gagné contre Deliveroo, évoquons brièvement le Collectif des coursiers et le mouvement social. Pour le grand public, la rupture de la convention avec la Smart, évoquée tout à l’heure, est un moment charnière, par les grèves provoquées en retour dans l’espace public.
Il y a eu plusieurs moments charnières, mais en effet, c’en est un important… On peut, à ce moment, parler de véritable mouvement social des livreurs, notamment par l’arrivée, aux côtés du Collectif existant, de personnes actives au sein de la Smart pour alimenter la lutte contre le nouveau paiement à la course. Le Collectif des coursiers a connu plusieurs vies, ce ne sont plus les mêmes personnes, car la population des livreurs se transforme constamment. Ce roulement est une difficulté majeure dans cette lutte pour le statut de salarié, et un élément d’explication du besoin de ces entreprises de travailler avec des populations très précarisées. S’ils sont sans-papiers, par exemple, certains ne lèveront pas trop la tête, pour ne pas se la faire couper… Cela dit, lors d’une grève de l’an dernier, nous avons été étonné de constater l’existence d’un vrai mouvement, y compris avec des livreurs sans-papiers, c’est la magie imprévisible du groupe, de l’action collective. Que votre employeur nie l’être officiellement ou pas, ça ne change rien au principe de la grève : l’arrêt de travail pose naturellement problème à celui qui est visé. Nous en revenons ici à la base du syndicalisme : le jour où tous les livreurs s’arrêteront, il n’y aura tout simplement plus de livraisons.
Cela dit, contrairement aux autres lieux de travail, ici la sanction peut être la déconnexion du travailleur, signant la fin du travail, une raison pour laquelle certains livreurs se masquent parfois, pour ne pas être identifiés comme manifestants ou grévistes. Un moyen pour eux de faire pression sur l’entreprise est de ne pas répondre aux commandes, mais ça reste théorique, parce que si vous refusez toutes les commandes, l’entreprise vous déconnecte. Il est aussi possible d’accepter les commandes et de ne pas aller les réceptionner au restaurant : c’est l’acte de résistance par lequel le livreur s’expose le plus, mais c’est déjà arrivé. Il y a eu des rassemblements, des manifestations, des invasions des bureaux de Deliveroo… Des pressions ont aussi été exercées sur les restaurants, pour qu’ils refusent de se connecter avec Deliveroo lors d’une grève, et des salles de restaurants qui ne voulaient pas faire cela ont été envahies. Tout est bon pour rendre visible la situation, mais cette lutte est très compliquée, et cette question de la déconnexion – un licenciement sauvage – est au cœur du besoin d’appliquer le statut de salarié à ces travailleurs.
Voilà la revendication principale du mouvement social, affirmée comme une nécessité par un jugement de décembre 2023. Ce jugement est très clair : les livreurs de Deliveroo doivent être requalifiés en salariés, or ce jugement n’est toujours pas appliqué : que se passe-t-il ? (sur le jugement)
Ce jugement en appel dit deux choses importantes. Point un : le régime de l’économie collaborative ne peut pas s’appliquer à ce secteur – le premier jugement de 2021 l’affirmait également -, et c’est écrit noir sur blanc dans la loi. Puisque ce régime n’est pas applicable, il faut préciser si ces gens sont indépendants ou salariés. Ce qui nous amène au point deux : le jugement affirme la nécessité d’appliquer le statut de salarié.
Que se passe-t-il ? Bonne question. Le jugement est prononcé le 21 décembre 2023. Le 4 janvier 2024, j’écris au cabinet du ministre des Finances de la dernière législature, Vincent Van Peteghem (CD&V), en demandant l’annulation immédiate du ruling permettant à Deliveroo d’utiliser le régime de l’économie collaborative, contre l’avis de la loi et, ensuite, du jugement de justice. Mon idée est de suggérer de commencer « proprement » le nouvel exercice, puisque tout fonctionne fiscalement par année civile, il semblait logique que personne ne commence à travailler en P2P en 2024. Réponse du cabinet ? « Nous sommes occupés à analyser ce jugement. » Bon, admettons, mais c’est dommage car l’année fiscale débute mal.
En mars 2024, je reprends contact. En trois mois, un cabinet ministériel a normalement eu le temps d’analyser une décision de justice aussi fondamentale, impliquant autant de personnes en Belgique, car on parle grosso modo de 3.000 livreurs inscrits sur les plateformes. Réponse ? « Ne mettons pas la charrue avant les bœufs, et puis peut-être que Deliveroo va aller en cassation. » Des élus, qui suivent le dossier, ont relayé les questions dans l’enceinte parlementaire, qui a fait la même réponse : possible recours en cassation, donc prudence. Mais le recours n’est pas suspensif, le jugement est donc applicable tout de suite, au moment-même où je discute avec les membres du cabinet du ministre ! Je signale donc : « Vous prenez un impôt sur un régime P2P qui ne peut s’appliquer, qui n’est pas légitime, donc vous êtes occupés à créer une situation administrative totalement chaotique ! » (à ce sujet, lire également l’encadré).
Au moment où se déroule notre discussion au cabinet, Deliveroo n’a pas introduit de recours en cassation : « Peut-être qu’ils le feront », répondent nos interlocuteurs… Invitent-ils, implicitement, à l’introduction d’un recours, afin de pouvoir invoquer une excuse pour ne rien faire ? Pas de réponse… Peu après, le recours en Cassation a effectivement été introduit. Lorsqu’on lit cette requête en cassation, c’est nul, tout le monde pense qu’ils n’obtiendront pas raison mais en attendant, pendant un an, deux ans – parce que la cassation, c’est long – nous restons dans une espèce de no man’s land. Aujourd’hui, nous ne savons toujours pas où on en est, rien n’est clair, et aucun livreur n’est devenu salarié.
Chaos social, administratif et fiscal
L’impunité des entreprises de plateformes, et leur négation du droit social, ont de nombreuses implications et conséquences administratives. Nous avons interrogé notre syndicaliste sur le sujet.
Martin Willems. Sujet très intéressant, ces conséquences ! En effet, il y a des implications administratives en cascade, et elles sont fondamentales, avec notamment de gros problèmes avec l’administration fiscale. En 2019, je lui ai demandé audience, et ma demande a été acceptée car « C’est le droit pour chaque citoyen d’avoir la clarté sur ses conditions d’imposition ». Les gens de l’administration nous ont reçu, ont tout noté, et ensuite : grand silence. En 2022, je les ai interpellés à nouveau, aussi bien le ministre que l’administration : silence total. On ne nous a même pas répondu. Plus récemment, je les ai à nouveau interpellés, et à présent l’excuse pour ne pas répondre est que nous sommes en affaires courantes. (1) Mais nous ne demandons pas de promulguer une nouvelle loi, seulement d’appliquer la loi existante : ce sont des affaires courantes ! C’est totalement hallucinant. Qu’est-ce qu’on va faire ? On va recalculer les impôts, car on ne pouvait en fait pas percevoir les 10,7 % de l’économie collaborative ? D’un autre côté, les livreurs vont-ils devoir payer des impôts comme des salariés ? On va refaire ces calculs ? Quand ? Comment ? Des années après les prestations ?
Prenons un autre cas : celui des livreurs en régime P2P qui ont dépassé le plafond de revenus autorisés. Ils ont un moment été requalifiés en indépendants, d’office, par l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti). Aujourd’hui, après le jugement de décembre 2023 affirmant que les livreurs devaient être considérés comme salariés, l’Inasti ne peut plus faire ça : le jugement affirme que ce n’est pas possible ! L’Inasti va donc, logiquement, devoir revenir sur toutes les requalifications réalisées dans le passé : il va falloir rembourser les cotisations d’indépendant réclamées aux travailleurs. En outre, actuellement nous sommes dans une sorte « d’entre-deux », prolongé par l’inertie politique. En cas de dépassement du plafond, certains paient les cotisations sociales – il faudra leur rembourser -, d’autres n’en paient pas et se sont vu appliquer des procédures de recouvrement, qu’il faut mettre en suspens. Il va falloir régler toutes ces procédures, entamées ou non, rembourser ce qui doit l’être…
Autre exemple encore : le jugement va également avoir des implications sur l’ONEm. Il est demandé aux chômeurs qui ont presté pour Deliveroo de rembourser leurs allocations de chômage, mais, en réalité, le tribunal a statué sur le fait qu’ils avaient travaillé en tant que salariés. C’est donc l’entreprise qui aurait dû les déclarer, payer les contributions sociales, etc. Une fois que l’entreprise se sera conformée au jugement, il faudra faire le détail de ce que ces travailleurs doivent rembourser, la part de l’entreprise, etc. On va refaire ces calculs, pour tous ces gens ?
Les livreurs de repas vont être salariés, ça c’est sûr. Prochainement ou dans dix ans, je suis incapable de le dire, mais rappelons qu’ici, pour l’instant, nous n’exigeons jamais que le respect de la loi, même pas des augmentations de salaire, par exemple, ou d’autres choses… Nous dénonçons le temps que cela prend, la connivence de certains politiques et le chaos administratif qui règne depuis toutes ces années et qui s’accentue de jour en jour. Des gens enfreignent la loi, des impôts sont perçus alors qu’ils ne devraient pas l’être, des administrations réclament indûment des remboursements… Nous baignons dans un surréalisme total. C’est le chaos. Total. Chaos social, administratif et fiscal.
(1) Le gouvernement fédéral de février 2025, les lecteurs l’auront compris, n’avait pas encore été institué.
Pouvons-nous affirmer que, depuis décembre 2023, Deliveroo est de fait, en Belgique, au-dessus des lois ?
Oui, tout à fait. Uber Eats également, car des conclusions de la Commission relations de travail (CRT) vont dans le même sens pour cette autre entreprise, conclusions basées sur la nouvelle présomption de salariat introduite dans la loi belge par Pierre-Yves Dermagne depuis janvier 2023 (Lire l’encadré) Cette loi crée une présomption de travail salarié, pour autant qu’une série de critères soient remplis : la CRT a conclu que sept critères sur huit étaient rencontrés, alors que trois suffisent pour requalifier la relation de travail en salariat. C’est donc clair pour tout le monde.
Que fait l’Office national de Sécurité sociale (ONSS) ? L’ONSS a évoqué un moment une requalification pour les livreurs parties au procès, au nombre de 28. Et les autres ? Pour ceux passés par la CRT également, où siège d’ailleurs l’ONSS, ils devraient être requalifiés, mais ça ne s’est pas fait (2). En juin 2024, l’ONSS m’annonçait qu’elle allait suivre la décision de la CRT, c’était imminent. Presqu’un an plus tard : toujours rien. Suite au jugement, c’est à l’ONSS de calculer le paiement des cotisations sociales en tant que salariés : combien Deliveroo aurait dû payer par heure, combien pour un treizième mois, les congés payés, etc. L’ONSS a-t-elle fait son travail ? Impossible à savoir… En avril prochain, une nouvelle phase du procès Deliveroo va se dérouler, au cours de laquelle il va falloir calculer les conséquences financières, au centime près et rétroactivement, pour les plaignants victorieux. Mais puisque le jugement n’est pas appliqué, quelle sera la teneur des discussions ? Mystère…
Plusieurs décisions de la CRT en faveur des livreurs sont au sommaire du procès en cours, un procès contre Deliveroo a été gagné, un autre procès a été intenté pour utilisation abusive de données personnelles… et pourtant rien ne bouge. La situation est extrêmement préoccupante. Le seul argument pour ne pas appliquer le jugement, est l’attente du recours en cassation, alors que l’appel en cassation n’est pas suspensif. Même l’administration fiscale, en 2018 et 2019 avait dit que le régime P2P n’était pas applicable pour les livreurs de ces plateformes… L’administration fiscale ! Et aujourd’hui, le ministre des Finances ne veut pas changer ce ruling les autorisant à s’en servir. D’où vient ce ruling qui contredit ce qu’affirme l’administration ? C’est ahurissant.
Nous sommes clairement face à une connivence de certains responsables politiques. C’est clair, évident, mais pourquoi ? On ne comprend pas bien, personne ne pourrait même prétendre que cette position « défend l’économie », puisque cette forme d’économie en remplace d’autres, dans une concurrence déloyale. Repensons à Take Away : à ce rythme-là, cette entreprise qui agit en accord avec la loi et la justice, en employant des livreurs salariés, eh bien elle va disparaître ! Quelle est la logique ? On défend Uber Eats et Deliveroo, pour leur permettre de faire disparaître de vrais employeurs ? On prétend aux électeurs qu’on veut augmenter le taux d’emploi, et on envoie des gens au chômage ?
Donc oui, ces entreprises se placent au-dessus des lois, sans aucune retenue. Elles refusent ouvertement de respecter la loi, c’est totalement anti-démocratique. Et malgré des procès perdus, elles persistent, avec des arguments d’un cynisme total couplé à un mépris intégral des institutions. Les autorités laissent faire… Nous sommes très inquiets.
La Maison des livreurs
Pour pallier l’absence d’un lieu collectif de travail, une Maison des livreurs a ouvert ses portes à Ixelles, en Région bruxelloise. Elle organise des permanences dans ses locaux, mais également en rue, pour se rapprocher des livreurs lorsqu’ils assurent leurs shifts de livraison. Ces permanences de rue ont été créées dans les environs de la chaussée d’Ixelles, un lieu stratégique pour les livreurs en Région bruxelloise, mais elles se déplacent également au sein de la commune d’Ixelles et ont parfois été également organisées à Gand, Liège, Anvers ou Charleroi.

Martin Willems : Un des problèmes principaux du syndicalisme, face à ce secteur des plateformes, est de « trouver » les travailleurs, les rassembler, puisqu’ils ne sont pas réunis dans un lieu central de travail. Le syndicalisme traditionnel va aux portes de l’usine, par exemple, parler aux travailleurs qui arrivent sur leur lieu de travail ou le quittent puis, au fur et à mesure, on commence l’organisation. Ici, les travailleurs sont éparpillés, c’est donc plus compliqué. Ceci dit, ces travailleurs-là, qui assurent les livraisons de repas, ils sont visibles. Ce n’est pas le cas de nombreux autres travailleurs de plateformes. On parle beaucoup des plateformes de livraisons de repas, car ce sont celles qui, de loin, utilisent le plus de travailleurs, mais il y a tout de même 152 plateformes en Belgique dont les activités sont reconnues comme relevant du régime de l’économie collaborative. On en trouve entre autres dans les services de santé, les services de soins aux personnes, les garde-malades, le baby-sitting, le soin aux enfants, les leçons particulières, ou pour des « services divers », comme par exemple le jardinage ou la plateforme Wash, qui propose de faire votre lessive chez vous, avec votre machine… Quelqu’un vient, fait votre lessive, puis s’en va. Ces travailleurs-là, nous ne les voyons pas, nous ne savons pas qui ils sont, sauf si l’un d’eux nous appelle, ce qui est très rare.
Ces travailleurs sont issus de populations très éloignées des syndicats. Ils ne parlent pas toujours bien notre langue, ne savent pas ce qu’est un syndicat belge, et s’ils le savent, ils se disent souvent qu’ils sont là pour les travailleurs traditionnels, « Ce n’est pas pour nous ! ». Pour soutenir et défendre les livreurs de plateformes, il faut aller les trouver là où ils sont. Nous sommes également face à des formes de travail construites pour qu’on n’ait jamais besoin de travailler avec ses collègues, et qu’aucune solidarité ne se crée comme sur un lieu de travail. C’est de ces constats qu’est née La maison des livreurs. Nous avons voulu créer un lieu, proche d’eux, où les livreurs viennent se reposer entre deux shifts, boire un café et socialiser, parler avec d’autres. Ils peuvent y recevoir des conseils administratifs et juridiques et peuvent également, pourquoi pas, y élaborer des actions sociales et politiques…
Les forces vives du lieu sont assurées essentiellement par le Collectif des coursiers, United Freelancers, le Mouvement ouvrier chrétien (MOC), quelques volontaires bénévoles qui ont été livreurs dans le passé, ou encore les jeunes CSC (confédération des syndicats chrétiens) et la FGTB (Fédération générale du travail de Belgique).
La Maison des livreurs : Rue du Trône 95, 1050 Bruxelles
Tél. : 0499/843.983
Mail : maisondeslivreurs@gmail.com
Site : www.linktr.ee/maisondeslivreurs
Permanence : Le vendredi de 14h à 18h (mais ça peut évoluer : prendre contact par téléphone ou mail pour des informations actualisées).
Cela arrive souvent, de ne pas respecter des décisions de justice majeures ?
Non, mais nous avons l’exemple récent des jugements concernant le non-respect par l’État belge de ses obligations en matière d’accueil des demandeurs d’asile. Des milliers de condamnations sont restées sans effet et l’Organisation non gouvernementale (ONG) Ligue des droits humains (LDH), dans une émission de télévision, a rappelé cette information en la mettant en parallèle avec la décision de justice concernant Deliveroo, elle aussi non suivie d’effet. Ces deux exemples ont été cités conjointement par la LDH, pour souligner que la période était très grave.
En tant que syndicalistes, nous nous positionnons depuis des décennies sur le droit du travail, qui ne va pas assez loin, dont certains pans sont détricotés, etc. Mais, au moins – si l’on peut dire -, les entreprises le respectaient globalement. Vaille que vaille, l’inspection du travail, les syndicats, essayaient de faire respecter la loi. Il y avait, grosso modo, une base consensuelle en vertu de laquelle on respectait la loi, et les entreprises ayant pignon sur rue la respectaient globalement. Aujourd’hui, nous sommes entrés dans une autre phase : ces entreprises multinationales estiment ouvertement que ces lois ne leur conviennent pas, et elles décident de ne pas les respecter. « Ça ne correspond pas à notre modèle. Nous sommes actifs dans le monde entier et n’avons rien à faire de vos lois nationales. » Elle font simplement comme si ça n’existait pas. Et les autorités les laissent faire.
Quel message envoie-t-on à la population, que peut encore représenter l’État de droit, si même le gouvernement ne respecte pas les décisions de justice ? En tant qu’habitant de ce pays, en tant que syndicaliste et personne soucieuse du respect de la démocratie, cette arrogance impunie m’effraie beaucoup. Car c’est bien de démocratie dont il est question ici.
- Par Gérald Hanotiaux (CSCE)
(1) Le Service public fédéral (SPF) Finances décrit cette pratique de cette manière : « Unruling (décision anticipée) peut être défini comme une décision par laquelle le SPF Finances détermine comment les lois d’impôts s’appliqueront à une situation ou à une opération précise qui n’a pas encore produit d’effets sur le plan fiscal. Ce ruling donne au demandeur la sécurité juridique car il lie tous les services du SPF Finances, en d’autres termes tous les services du SPF Finances doivent le respecter. » www.ruling.be
(2) Depuis la rencontre avec Martin Willems, une nouvelle décision de la CRT, en faveur de la requalification en salariat, est tombée pour trois livreurs. Pour toute réaction de l’employeur, ces derniers ont reçu une lettre recommandée de Uber Eats annonçant… la fin de la « collaboration ». En langage clair : ils sont licenciés.