presse
Le « fait » : ce grand absent de nos bavardages
Nos vies sont devenues bavardes : tel est, en substance, le constat inquiet posé par la philosophe et politologue française Géraldine Mulhmann. Ce bavardage, explique-t-elle dans son livre « Pour les Faits », est non seulement vain et bruyant mais, plus grave, il engloutit la « matière factuelle », c’est-à-dire le fait dont on est censé parler, au profit du commentaire, de la narration subjective et partisane.

Pour ne pas s’en rendre compte, il faut être ermite ou moine. Car même celles et ceux qui résistent aux sirènes des réseaux sociaux et des télés d’ « info continue » le sentent bien, pour peu qu’ils s’intéressent un tantinet à l’actualité et à la marche du monde: ce dont on parle, ce qu’ils entendent à la radio ou ce qu’ils lisent dans la presse, est plus souvent de l’ordre du commentaire que de l’enquête. Les enquêteurs partent à la recherche de faits, les commentateurs en causent, les égratignant souvent au passage, en fonction de leurs interprétations, de leurs « sensibilités ».
La sphère médiatique – qui depuis la montée en puissance des réseaux sociaux, regorge de « journalistes », est devenue très bruyante. Les plateformes comme X (anciennement Twitter) et Facebook permettent de commenter les faits à l’infini, et ce flux continu de discours tend à diluer la matérialité de l’information rendant les faits eux-mêmes invisibles ou douteux. Ces réseaux débordent de nos commentaires, de nos indignations, de nos condamnations, de nos émotions, de nos opinions qui se superposent et s’opposent sans jamais s’infléchir.
La conversation impose sa loi
Dans son livre « Pour les Faits » (1), Géraldine Muhlmann insiste :« Notre espace médiatique contemporain est envahi par du ‘‘discours’’ conversationnel. Sites pour commenter les émissions et tout ce qu’on y entend, en invitant à prolonger les échanges sur les réseaux sociaux ; tables rondes se succédant toute la journée sur les chaînes d’information continue, etc. : la conversation installe sa loi. Et, ne serait-ce que du point de vue du temps disponible, le ‘‘récit’’ factuel des histoires du monde passe au second plan, fragilisé. Les ‘‘faits’’ se retrouvent pris dans un registre de parole qui est très majoritairement celui du ‘‘discours’’, c’est-à-dire du commentaire, de l’argumentation, du débat, de la narration partisane, qui prend le pas sur le fait lui-même. »
L’avantage du commentaire, c’est qu’il peut se décliner longtemps, à toutes les sauces, là où le fait est généralement plus sobre, et se doit d’être minutieux. Certains responsables politiques le savent bien : pour faire le buzz sur la Toile, rien de tel que d’asséner une petite phrase-choc (une punchline, dit-on dans le jargon journalistique), qui va tourner en boucle, avant de se dissoudre dans une conversation plus large, dans laquelle pourfendeurs et défenseurs tenteront inlassablement de se voler la vedette, tout en continuant de nommer, de-ci de-là, celui ou celle qui détient la paternité ou la maternité de la petite phrase, ce qui est, somme toute, l’effet qu’iel recherchait.

Le reporter contre le chaos social
La philosophe fait ainsi la distinction entre le « récit » et le « discours », comme l’avait théorisé avant elle le spécialiste de la littérature Gérard Genette (1939-2018) : « Le discours, c’est une humeur, une opinion, c’est ce qui prime aussi dans la conversation. On dit ‘‘je’’, on assume une subjectivité, il n’y a aucun problème. Le récit, c’est autre chose. Par nature, le récit exige d’objectiver un peu les événements dont on parle. Et c’est d’ailleurs pourquoi le récit ne va pas de soi (…). Il crée un moment particulier où on raconte les faits, l’enchaînement des événements, il exige du temps et de l’attention », recadrait-elle sur France Culture en novembre 2023 (2).
Et sur qui pouvons-nous compter pour nous faire un récit des faits ? Sur le reporter, répond Muhlmann. Un reporter qu’elle définit comme un « observateur impartial ». Car pour la philosophe, la notion de fait est étroitement liée à celle de l’impartialité, et l’impartialité étroitement liée à la position du reporter, c’est-à-dire de ce journaliste témoin et garant des faits, qui lutte contre ses propres biais idéologiques pour nous rendre compte de ces faits, le plus fidèlement possible, comme si nous y étions. « L’impartialité, c’est une certaine situation du témoin par rapport à ce qu’il a vu et senti. Rapporter une scène de la manière la plus impartiale possible, c’est essayer de défaire au maximum ce lien naturel qui relie nos sensations et émotions à des jugements évaluatifs ; et puis, plus profondément encore, c’est essayer de ‘‘sentir’’ comme sentirait n’importe qui. La factualité renvoie à quelque chose de partageable. »
Pour partager cela avec nous, il faut un « observateur impartial ». Lorsque cette figure ne « fonctionne » plus – et Muhlmann craint que nous en soyons arrivés à ce point, dans l’histoire de la démocratie contemporaine, où elle est profondément mise en cause -, « alors se lit quelque chose qui évoque un certain chaos social, craint-elle. La fin du partage sensible, ce n’est pas rien, pour une société. »
Ne pas taire les faits, même s’ils dérangent
Et Muhlmann de répondre à ceux qui lui rétorqueront qu’en choisissant de se focaliser sur certains d’entre eux, de rapporter tel fait « au détriment » d’un autre, le reporter fait déjà preuve, là, de partialité, que l’impartialité, c’est aussi la conscience aiguë du fait qu’on ne voit jamais « tout ». Que la quête d’impartialité, c’est en réalité le sens du « partiel ». « Savoir que peut-être, en étant ici, et non là, on a manqué quelque chose d’essentiel qui se passait là. « La texture sensible d’un événement, d’une situation, d’une guerre, ne peut être saisie autrement, souligne Muhlmann. Il faut se situer dedans, et cela interdit tout perspective totale. » Pour rendre concret ce que dit Muhlmann, prenons le reportage des journalistes de l’émission télé Pano (VRT) mettant en exergue, en novembre 2024, les dysfonctionnements du CPAS d’Anderlecht (3) : ce reportage a suscité la polémique parce que les dysfonctionnements qu’il mettait en exergue ne disaient pas « tout » de la réalité du CPAS d’Anderlecht, et encore moins « tout » de la réalité des CPAS des communes défavorisées.
Vaine polémique, rétorquerait assurément la philosophe : il était impossible, dans une seule émission, d’embrasser tous les dysfonctionnements, toute la réalité du CPAS d’Anderlecht, et toutes les réalités de tous les CPAS. Le choix du sujet principal, cela s’appelle l’ « angle », en journalisme : pas de sujet sans « angle ». Et cet angle impose des choix. Et ces choix, on peut le regretter mais c’est ainsi, on les pose « en pensant à ce qui intéresse le plus les gens », à ce qui va faire « vendre ». « La question des faits dans la profession journalistique, écrit Muhlmann, est prise dans ce problème d’équilibre, qui engage des enjeux de gros sous (NDLR : oui, pour survivre, les médias en général, et les émissions télé en particulier, doivent faire de l’audience, avoir un impact) mais aussi, il ne faut quand même pas l’oublier, de courage ». Du « courage » ? Oui : il arrive que pour flatter « son » public dont chaque média se fait une idée, on renonce à faire droit au complexe, on simplifie à outrance, on résume, on fasse l’impasse sur une réalité qui se superpose aux faits que l’on observe, à des faits qui sont pourtant bien là, immédiatement visibles, à côté de ceux que l’on a pris pour angle.
Dans le reportage en question, plusieurs faits nous ont été donnés à voir, qui content une réalité complexe, tout en rendant très visible une facette de la réalité (les aides financières indûment perçues par certains demandeurs), et un peu moins les autres (tels les délais dramatiquement longs des traitements des dossiers). La polémique autour de ce reportage est née, non pas des faits eux-mêmes qui ont été relatés, mais bien du « discours » autour de ces faits, des interprétations politiques de ces faits, du choix d’ « angle » que les uns et les autres, en fonction de leur sensibilité, auraient préféré différents, de ces morceaux fatalement parcellaires de réel que certains auraient aimé qu’ils soient tus, au profit d’autres qui auraient davantage collé à leurs convictions idéologiques. Souvent, en effet, on reproche à ceux qui relatent des faits de « faire le jeu de l’extrême droite ». L’intention des détracteurs est bonne, mais les choses leur ont donné tort. Jamais la presse n’a été autant en crise, et cette crise de confiance vient justement, entre autres, du fait que pendant longtemps, des faits ont été occultés de peur de faire le lit de l’extrême droite.
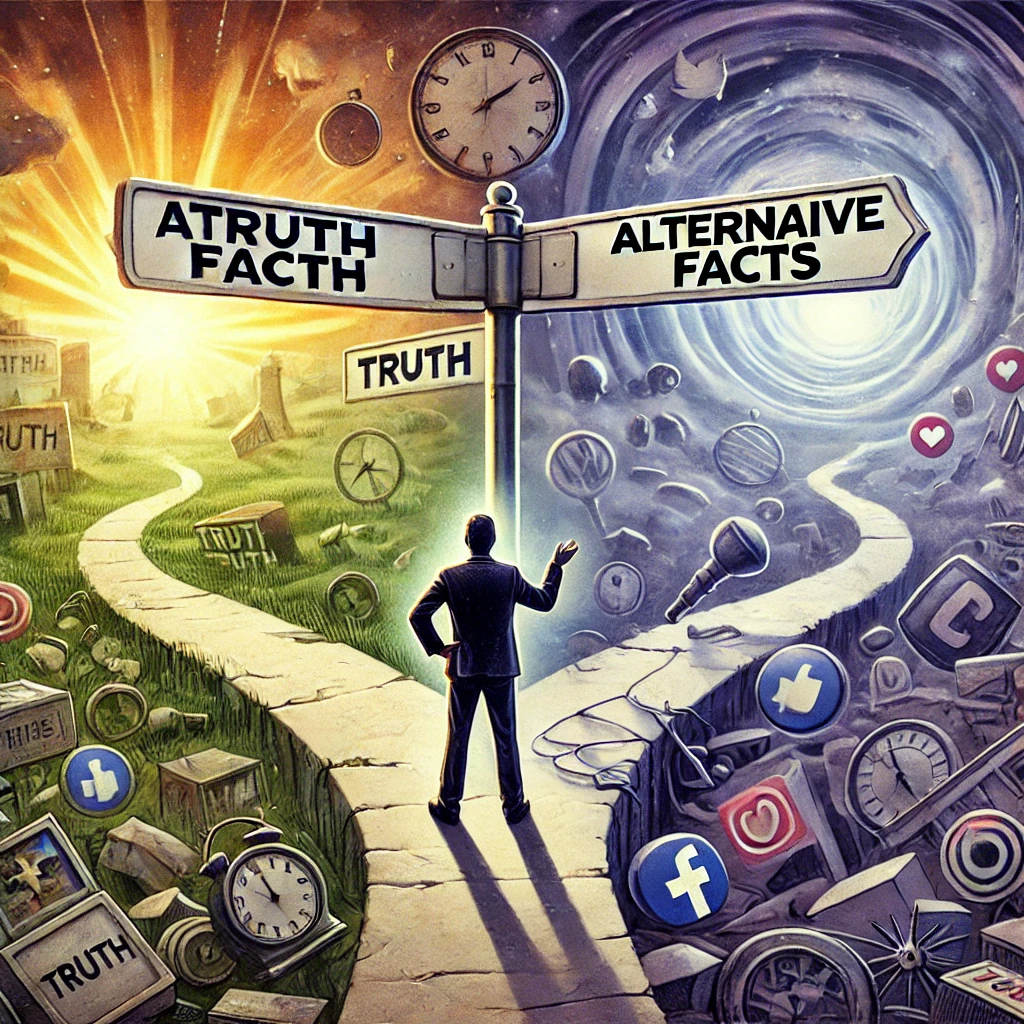
Les réseaux sociaux et le morcellement du public
Cette crise de la presse mainstream s’est accompagnée, en parallèle, du succès de plus en plus grand des réseaux sociaux qui, eux, « ne cachaient rien ». A leurs débuts, effectivement, le mérite de ces réseaux était de nous faire voir des faits que l’on occultait ou minimisait ailleurs. Au fil du temps, cependant, les mots y ont été préférés aux faits, les discours y ont explosé, à un point tel qu’on ne sait le plus souvent même plus de quoi on débat.
Et ces mêmes réseaux, en proie aux discours, ont morcelé les publics.Les réseaux nous présentent soit des choses qui nous plaisent et vont renforcer ce que nous pensions déjà, soit des contenus qui suscitent notre indignation et que nous rejetons immédiatement : les lieux où nous pouvons débattre sereinement sur une base factuelle reconnue de toutes et tous ont disparu de façon brutale. Cette disparition s’est opérée au profit des récits partisans et des fake news, qui ont continué de fragmenter la perception de la réalité. « Les fake news ne datent pas d’hier, rappelle Muhlmann. Mais aujourd’hui, plusieurs éléments ont produit une situation nouvelle, qui favorise leur production et leur diffusion. Il y a cette petite musique qui s’approche : ‘‘du vrai, du faux ou du presque-vrai, quelle importance au fond ! Les faits viennent et passent, est-ce si grave tout cela ?’’ La fake news n’est que la pointe la plus spectaculaire d’une tendance générale à perdre le sens de la texture factuelle du monde et des événements qui s’y produisent. » On sent cette tentation de jeter l’éponge et de laisser gagner les positions qui relèguent les notions de « faits » et d’ « impartialité » aux oubliettes. Mais, si l’on fait son deuil de toute idée de « fait » collectivement recevable, il faut savoir sur quel terrain on s’engage, prévient la philosophe : on s’engage sur le terrain « d’une fracturation assumée, pourquoi pas définitive, du ‘‘commun’’ (…). Car déjà les publics d’aujourd’hui sont de plus en plus morcelés. Déjà, sur les événements du monde et de notre pays, nous lisons, entendons, regardons de moins en moins les mêmes récits. Et déjà, beaucoup ne lisent plus de récits du tout, préférant les commentaires sans fin des réseaux sociaux et des émissions dites de talk. »
Le trumpisme est un état d’esprit
L’essai « Pour les faits » constitue un plaidoyer pour le retour à une approche rigoureuse des faits dans un contexte où les opinions et les interprétations dominent le discours public. Muhlmann voit dans la reconquête de la factualité, non seulement un enjeu pour le journalisme, mais aussi un impératif démocratique : il s’agit de rétablir la confiance dans l’information en renforçant le lien entre les faits et le débat public, permettant ainsi à la société de naviguer dans un monde de plus en plus complexe et fragmenté. La philosophe, qui est aussi spécialiste de l’histoire du journalisme, propose de réhabiliter le rôle du journaliste comme garant de la factualité. Elle en appelle à un retour du journalisme d’enquête, rigoureux, fondé sur la vérification des faits et la description du monde tel qu’il est, plutôt que tel qu’on aimerait qu’il soit. « Elle met en avant l’idée d’un ‘‘journalisme de l’expérience’’, qui permettrait au public de se connecter à la réalité à travers le récit authentique d’événements, plutôt que par des commentaires abstraits ou des analyses biaisées » (4).
« Le récit authentique d’événements », par des témoins qui les ont vécus, observés de près : voilà une denrée qui devient de plus en plus rare. Les « faits alternatifs » – l’expression a été popularisée par Kellyane Conwy, la conseillère de Donald Trump -supplantent bien souvent la réalité, et on n’en a pas fini avec eux. Pour à peu près chaque fait « déplaisant » pour l’une ou l’autre frange de la population, des « faits alternatifs » existent : « le trumpisme est un état d’esprit, au cœur de la virtualisation du monde. »
Les réseaux sociaux, mélange de relativisme et d’intolérance
Les faits n’ont pas la cote sur les réseaux sociaux, où le « discours » tient le haut du pavé. Cette diversité d’opinions conduit-elle à plus de tolérance ? Au contraire : ma vérité ne saurait être remise en question.
A leurs débuts, les réseaux sociaux promettaient de vivifier la démocratie : ils donnaient de façon inédite à voir des pans entiers de la société, du monde, que les médias traditionnels taisaient souvent. Ainsi, Géraldine Muhlmann salue la curiosité des journalistes (au sens large) qui se sont rendus sur les ronds-points occupés par les Gilets jaunes, et rappelle que beaucoup de journalistes professionnels se sont contentés, pour leur part, de « parler de » ou « sur » ce mouvement social, sans aller à sa rencontre : « Ceux et celles qui se sont rendu.es sur le terrain ont souligné à quel point on rencontrait là des visages qu’on ne voyait jamais dans les médias, des réalités totalement ignorées, invisibilisées », souligne-t-elle.
En cela, les réseaux sociaux n’ont pas toujours participé à la « virtualisation » du monde, au contraire. « Mais peu à peu, regrette Muhlmann, ils ont participé à cette déferlante.Cette déferlante, c’est-à-dire ce flux ininterrompu, monstrueux, de discours les plus divers, de conversations, d’humeurs, de commentaires sans fin, qui finissent par engloutir la matière factuelle dont on est censé parler. Le fait originel a, en quelque sorte, perdu pied. Flot gigantesque où ce dont on parle se retrouve ‘‘derrière’’tout ce qu’on en dit. »
Le « discours », c’est-à-dire l’humeur, l’opinion, règne en maître sur les réseaux sociaux, au détriment des faits : « Nous sommes dans le discours presque tout le temps – et d’ailleurs pas seulement sur les réseaux, mais aussi beaucoup dans les médias traditionnels -, et non pas dans le récit factuel, dont la place rapetisse. Le récit, notamment journalistique, est gravement en crise, relevait Muhlmann sur France Culture en novembre 2023. Nous n’arrivons même plus à nous mettre d’accord sur les faits. Il y aurait des faits CNews ou Fox News, et des faits médias mainstream ou politiquement corrects. L’échange public est miné par cette conviction : ‘‘A chacun ses faits’’.
Ce relativisme, l’idée qu’il faut déconstruire, avoir l’esprit critique, que la vérité n’existe pas, pourrait au moins avoir ceci de bon qu’il devrait en principe nous conduire à davantage de tolérance : après tout, s’il n’y a pas de faits mais seulement des interprétations de ces faits, et si toutes les opinions se valent, alors il ne devrait y avoir aucun problème à accepter les opinions d’autrui. « Mais non, sur les réseaux, c’est l’intolérance qui règne : la vérité que je ressens ne saurais être remise en question, remise en doute. Et c’est cela, conclut Géraldine Muhlmann, qui caractérise le débat sur les réseaux sociaux : ce mélange d’intolérance et un relativisme complet.
Le journalisme contre la vengeance de la rumeur
Et avec la montée en puissance incroyablement rapide de l’Intelligence Artificielle (IA), c’est désormais au deep fake que nous voici confronté.es. En effet : l’IA peut fabriquer des vidéos dans lesquelles interviennent des personnes vivantes, avec leur voix « naturelle », mais tenant des propos inventés de toutes pièces, ou « arrangés », caricaturés, détournés. Nous aurons donc de plus en plus de mal à faire confiance à quoi que ce soit et à qui que ce soit qui nous arrive ainsi de la Toile. Du moins les plus critiques d’entre nous, car le risque est évidemment grand qu’un nombre imposant de personnes prennent pour argent comptant tout ce qu’elles voient apparaître sur leur écran connecté.
« Cela évoque, conclut Muhlmann, une troublante vengeance de la rumeur. » Pour lutter contre ce fléau qui menace les fondements des démocraties, la philosophe insiste sur l’urgence de renforcer les médias traditionnels, de rendre plus solide leur modèle économique aujourd’hui fragilisé par la gratuité de l’information sur le Internet. Elle pointe aussi l’absolue nécessité de renforcer l’éducation aux médias et la formation des journalistes. « Tordre le cou aux rumeurs en disant les faits – que ces derniers confirment les premières ou les infirment – est bien la quintessence du travail du journaliste », rappelle-t-elle. Le fact checking, ce terme à la mode que l’on utilise désormais pour parler de la vérification de l’info, c’est, tout simplement, du… journalisme.
- Par Isabelle Philippon (CSCE)
(1) « Pour les faits », Géraldine Muhlmann, Les Belles Lettres, Paris, 2023.
(2) « Les faits et les sentiments », sur France Inter, le 11 novembre 2023.
(3) « OCMW op drift”, Pano, VRT, 19/11/2024; https://www.vrt.be/vrtmax/a-z/pano/2024/pano-s2024a10/