presse
Le reporter, clé de voûte du journalisme et de la démocratie
Et si la reconquête d’une factualité commune était non seulement l’enjeu essentiel pour la réhabilitation du journalisme, mais aussi une condition de survie de la démocratie ?
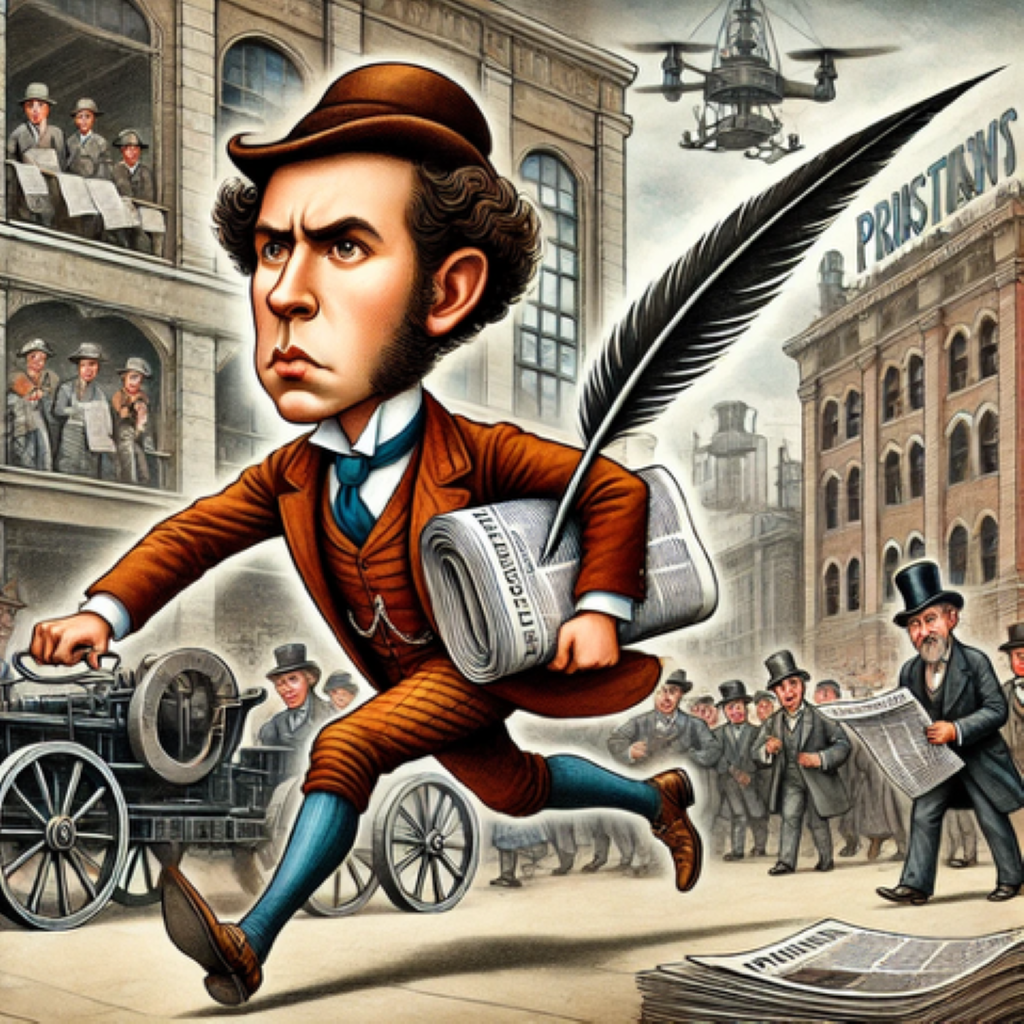
La philosophe et politologue Géraldine Muhlmann plaide avec force pour le retour à une approche rigoureuse des faits, dans un contexte où les opinions et les interprétations dominent la « conversation publique ». Il s’agit donc de rétablir la confiance dans l’information, en renforçant le lien entre les faits et le débat public.
Car, qu’est-ce que la réalité des faits, si ce n’est une réalité « objective » partagée, qui devrait être la base d’un débat public véritablement « éclairé » ? Muhlmann critique l’affirmation de Nietzsche, ou plutôt le sens erroné qu’on lui prête trop souvent – selon laquelle « il n’y a pas de faits, seulement des interprétations ». Elle souligne au contraire l’importance de la reconnaissance commune d’un socle factuel, préalable indispensable à toute discussion constructive. « Comment sentir, et comment raconter pour que cela soit reconnu largement comme un ensemble de faits s’imposant à tout le monde, par-delà les jugements divers que ces faits peuvent occasionner : tel est l’enjeu fondamental du journalisme moderne », insiste la philosophe. Et, à ses yeux, c’est le journaliste-reporter qui, le mieux, peut rendre compte de ces faits, et à lui qu’il incombe d’être un « témoin-ambassadeur » du public.
Le métier de reporter…
Le « métier » de reporter a émergé aux Etats-Unis au cours du XIXè Siècle : ce sont les grands journaux populaires qui l’ont mis à l’honneur, eux qui se faisaient les garants de la factualité, contrairement à la presse aristocratique qui, elle, était axée sur le commentaire. Ces patrons de presse nourrissaient l’ambition de toucher un public plus large que celui de la presse d’opinion, des lecteurs aux valeurs hétéroclites, mais capables de savourer les mêmes « récits ». Pour ce faire, il fallait autre chose que des analyses, des tribunes, des éditoriaux, des commentaires, des critiques culturelles, autant de « formats » qui relèvent prioritairement du « discours ». « Désormais, dans les journaux, on allait pour l’essentiel raconter des histoires (stories), c’est-à-dire proposer du récit. Ces histoires devaient être vraies : la fiction et l’approximation ne marchaient pas. L’information moderne(était née), en posant l’idéal d’un observateur impartial qui verrait et raconterait pour tout le monde. »
Au XIXè Siècle, les patrons de presse ont décidé que désormais, dans les journaux, on allait raconter des « histoires »
Et cet observateur, donc, était prié de ramener des faits, et de les décrire de la façon la plus « impartiale » possible, c’est-à-dire en tentant au maximum de taire ses propres biais cognitifs après, étape préalable, en avoir pris conscience. Les « faits » sont donc devenus une notion centrale dans la presse de la fin du XIXè Siècle. « Dans toutes les langues, on s’est mis à dire aux reporters : ‘‘Je veux du vrai, du tangible, du vérifié, des faits, que vous ne pourrez trouver qu’en sortant de ce bureau sans cesse, pour aller y voir en personne’’. »
… aux antipodes du journaliste rivé à l’écran
Aujourd’hui, ce métier de reporter est largement taillé en pièces. Avec Internet et les réseaux sociaux, le « discours » a opéré son retour en force : il occupe quasiment toute la place, et c’est autour de lui, des commentaires, des opinions des un.es et des autres, que s’articule le débat public. Même dans la presse « traditionnelle », qu’elle soit écrite ou audiovisuelle, les éditoriaux, les tribunes, les analyses, les billets d’humeur et les chroniques occupent bien davantage de place que la relation des faits. Pis encore : les fake news déferlent tant sur les réseaux qu’il devient difficile de discerner le vrai du faux, et même certains médias ayant pignon sur rue se sont fait une spécialité de tordre le cou aux faits, leur préférant la rumeur et autres « vérités alternatives » : sur la chaîne de télé CNews par exemple, les rumeurs les plus folles se retrouvent « discutées » à des heures de grande écoute.
Un peu partout dans les salles de rédaction, les journalistes soucieux de bien faire leur boulot, c’est-à-dire d’aller sur le terrain, à la recherche de faits desquels rendre compte, sont souvent « encouragés » à rester au bureau (c’est moins cher), pour « guetter les ‘‘infos’’ qui font le buzz sur le Net », et en faire de magnifiques « discours ».
- Par Isabelle Philippon (CSCE)